




Contraintes aléatoires Contraintes à sélectionner soi-même Testeur d'auxiliaire Situations aléatoires (défi de Schrödinger) Textes sans commentaires Générateur de situation/synopsis 
DĂ©fi de Faucheuse (Survivre Ă tout prix)

Elbaronsaurus
Spectacles
Elbaronsaurus Timeline
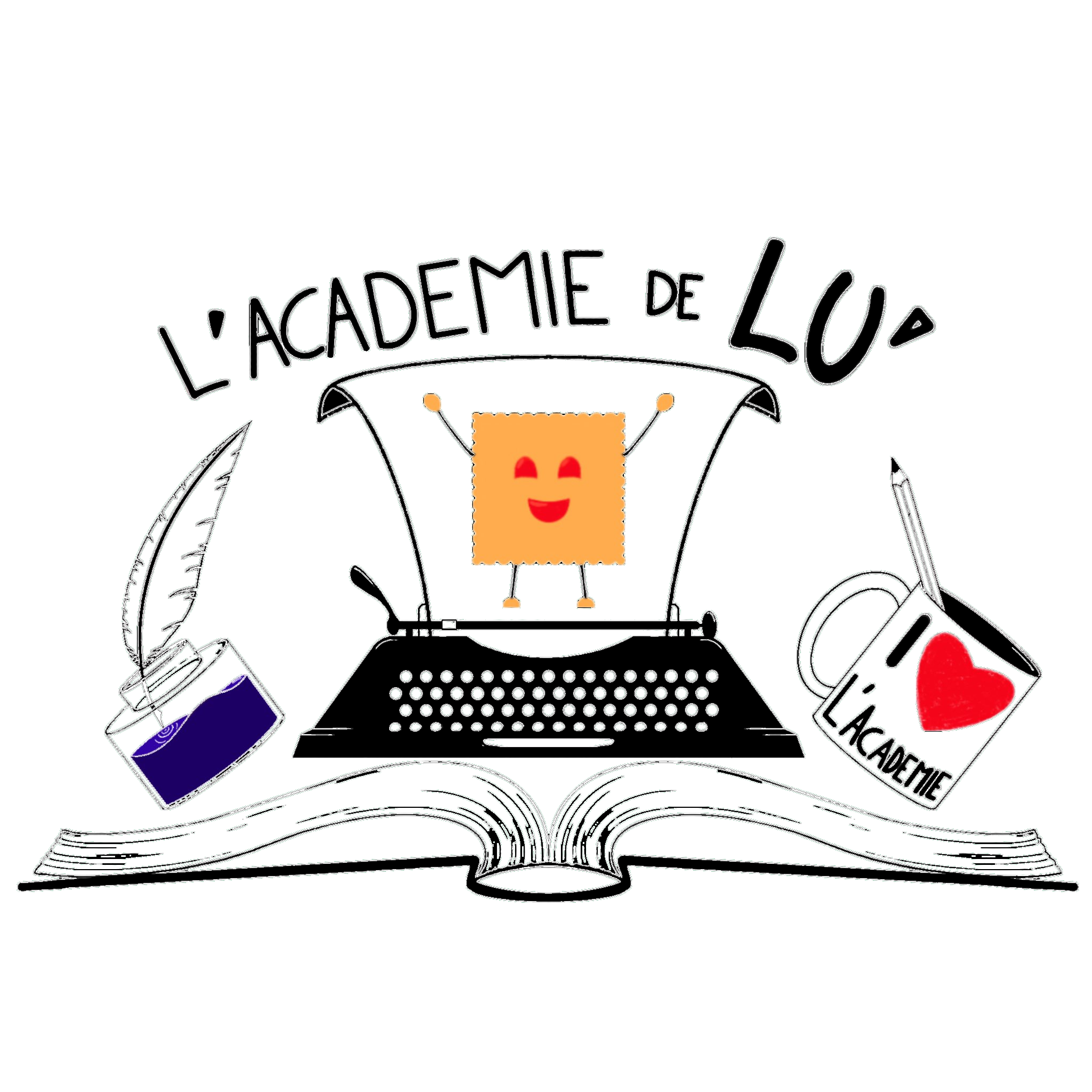  Migration(par Elbaronsaurus)J’ai l’impression que ses yeux me jugent. Je me sens bien mal à l’aise et je ne vais pas lui dire explicitement que je sens mon fondement détruit. Véritablement, la douleur qui s’était éveillée quelques instants après l’apparition blafarde du jeune garçon, m’envahissait littéralement le corps. Mais je choisis de faire mine de rien. Thomas reste d’abord sans bouger, attendant peut-être une réaction de ma part. Mais comme un idiot, je reste juste bouche bée. Je dis comme un idiot, mais je me sens véritablement stupide en cet instant. Alors, il se décide à s’extirper de ses draps, me rejoignant dans sa robe de chambre, s’asseyant sur ce qui semble être le lit qu’on m’a donné pour cette nuit.
— C’est mon père qui t’a rĂ©cupĂ©rĂ© dans la rue. Commence-t-il Ă m’expliquer. — Ah… Oui ? — On sait ce qui t’es arrivĂ©. Tu as rencontrĂ© les mauvaises personnes. N’aies pas honte, t’inquiète. T’es sans doute pas le premier Ă te faire avoir ainsi. — Comment ça ? — Ça fait quelque temps que mon père les soupçonne de faire des trucs bizarres. Mais il n’avait jamais encore obtenu de preuve. Quelque part, tu es celui qui aura donnĂ© un alibi Ă mon père. — Un alibi pour ? — Les mettre dehors. Ils vont ĂŞtre exclus de la communautĂ©. — Vraiment ? Je me sens toujours aussi stupide. — Ouais. T’inquiète pas, t’auras plus affaire Ă eux. Tu sais, on n’a pas vraiment de règle encore ici, pas de tribunal, ni de codes bien dĂ©finis. La communautĂ© est toute neuve et on n’a pas encore eu le temps de s’attarder lĂ -dessus. Donc nĂ©cessairement, les bavures du genre ça devait arriver. — Et c’est sur moi que ça tombe, forcĂ©ment. — T’es le nouveau, c’est normal qu’ils t’aient vu comme la proie idĂ©ale. Ce terme laissa m’échapper un frisson dans l’échine. — J’suis dĂ©solĂ©, on devait se revoir et… m’excuse-je. — T’inquiète pas, j’peux comprendre qu’à l’âge que t’as on a des prioritĂ©s qui ne sont pas encore tout Ă fait les miennes. Me rĂ©pondit-il en s’esclaffant. — Mais… — T’inquiète je te dis. Heureusement que des gens t’ont vu pĂ©nĂ©trer dans leur tente, le lien a Ă©tĂ© vite fait. Bon, malheureusement, vu dans l’état oĂą on t’a retrouvĂ© et ce qu’on a pu trouver chez eux, t’as pas dĂ» passer qu’un bon moment. — Non, c’est vrai. Dis-je penaud. — T’en veux pas, tu pouvais pas savoir. Me rassure-t-il en dĂ©posant une main dĂ©licate, froide et frĂŞle sur mon Ă©paule nue. C’est seulement Ă cet instant que je m’aperçois que je suis torse nu. Un sentiment de gĂŞne commence Ă m’envahir. Etrangement, au travers de la lumière de la lampe, il me semble percevoir que le petit l’entend ainsi et dĂ©tourne son regard en retirant sa main. — T’as eu de la chance. Reprit-il sans me regarder. — Comment ça ? M’étonne-je. — Je pense que t’aurais pu y passer cette nuit. — Tu le penses vraiment ? — Tu saignais beaucoup… si tu vois ce que je veux dire… Je le sens embarrassĂ©. — Si tu prĂ©fères… on en parle pas. Quelque part, ça m’arrange aussi. — Ouais c’est peut-ĂŞtre mieux. Il reste un instant Ă regarder vers son lit. Puis, il se tourne vers moi Ă nouveau. — Mais t’inquiète, je t’aime bien quand mĂŞme. J’veux toujours bien ĂŞtre ton pote d’handicap. — Ça me va ! M’exclame-je, avant de mettre une main devant ma bouche. — T’es surprenant toi (il rit), mais attention, mon père aimerait dormir je pense. — Oui, oui ! Souffle-je. Thomas se lève et se dirige vers son lit, replonge sous les draps et s’y allonge. — Je te prĂ©fère en vie, handicapĂ©, mais en vie ! Me lance-t-il alors. — Eh moi donc… mais si seulement ça avait Ă©tĂ© la première fois ! dis-je en souriant lĂ©gèrement. — Première fois que ? T’avais dĂ©jĂ eu ce type d’expĂ©rience ? — Non, non, jamais de ce type non. Juste que j’ai dĂ©jĂ Ă©chappĂ© Ă la mort auparavant. — Ah ouais ? — Dès ma naissance Ă vrai dire… si ma grand-mère n’avait pas Ă©tĂ© en pĂ©diatrie Ă l’époque, je n’aurais vĂ©cu que quelques mois… — Ah, chaud ! — Ouais… d’ailleurs ma grand-mère… je n’ai aucune idĂ©e si… — Il vaut mieux dormir que de penser à ça ! — C’est mieux oui. Dis-je en empĂŞchant une larme avec mon index. PrĂŞt Ă me laisser bercer malgrĂ© la douleur en me rallongeant, une idĂ©e fulgurante me traverse l’esprit. — Le chat ! Lance-je soudain en me rasseyant. OĂą est mon chat ? — T’inquiète. Me lance Thomas dĂ©jĂ presque assoupi. Il est dans son sac Ă cĂ´tĂ© de toi. Mon père est allĂ© te le chercher. Je vĂ©rifie. Il dit vrai. Le chat est lĂ , endormi. — Bien ton père, un mec bien ! Lâche-je dans un bâillement sonore.
Je finis par me rallonger, tentant de ne pas me reposer sur le dos, adoptant la position la plus confortable afin d’avoir le moins mal possible. Je sens alors qu’au niveau de mon bas ventre, quelque chose me recouvre. Une matière inhabituelle, sans doute semblable à celle qui recouvre mes brûlures. Mais, la fatigue me rattrape et je n’ai plus la force de me poser de question. Je me laisse alors totalement aller…
— Hey, lève-toi ! C’est l’heure, y a le p’tit dèj et mon père veut te voir ! — Huuuum ! grommèle-je. — Y a pas de ça qui tienne ! Allez prend tes affaires et habille-toi vite !
Un fatras de tissu me tombe sur le crâne alors que mes yeux refusent de s’ouvrir. Je n’ai aucune envie de me lever. J’ai encore mal. Mais, il insiste. Le voilà qu’il secoue mon lit. Alors d’un coup, je tends le bras en me mettant sur mon séant, les yeux encore légèrement collés.
— Mais… Il est quelle heure au juste ? marmonne-je. — L’heure de te lever feignasse ! Le soleil est bien levĂ© Lui. — Ah ouais, t’es comme ça toi. Tu ne perds rien pour attendre ! DĂ©clare-je sur un ton faussement menaçant. Je l’entends s’égosiller. — Tu me fais rire toi. Ouvre les yeux dĂ©jĂ avant de parler !
Dans un redoutable effort, j’arrive finalement à séparer mes paupières récalcitrantes. La douleur en moi est toujours présente, mais le fait d’entendre, puis de voir ce gamin s’amuser de moi me soulage presque. J’oublie l’espace d’un instant qu’on a abusé de mon corps. Qu’on l’a torturé, sans que je ne puisse m’en rendre compte. Je prends quelques secondes afin de détailler la pièce. Une entrée obstruée par un rideau de toile, une chambre faite de planches de bois grisâtres, une fenêtre rudimentaire, deux vieux lits, dont le mien, un placard, une table de chevet entre les lits et une étagère chancelante où repose une grande quantité de livres.
— Le fan de SF ! Lui dis-je finalement en dĂ©signant l’empilement d’ouvrages d’un signe de tĂŞte. — Eh ouais ! J’parie que t’as pas pu lire tout ce que j’ai, mĂŞme durant ta si longue vie ! — Tu me cherches toi ! — Ouais ! Ses yeux se confondent en deux accents circonflexes au-dessus de son nez retroussĂ© tant il sourit. — Bon allez, lève-toi maintenant ! Reprend-il d’un ton moins dĂ©contractĂ©. — Ok, j’arrive. Tu me laisse m’habiller ? — Heu, ouais ! Je t’attends de l’autre cĂ´tĂ©. Tarde pas trop.
Juste le temps de repasser mes vêtements par-dessus la couche de langes qui me recouvre le bas de l’abdomen et le fessier, puis de vérifier que le chat va bien et me voici en train de pénétrer dans ce qui semble être une pièce à vivre. D’allure aussi spartiate que la chambre de Thomas, elle offre cependant un grand espace où une table trône en son centre.
— Prends une chaise ! mets-toi Ă table. Me lance le jeune adolescent. Je m’exĂ©cute. — Bon, j’ai des cĂ©rĂ©ales, du lait. Mon père a laissĂ© du cafĂ© sur le feu. Tu prĂ©fères des gâteaux ? — T’as du lait ? dis-je surpris. — Ouais, au dĂ©but on prenait celui qu’on trouvait dans des briques, mais ça se conserve pas, tu sais. Du coup, on a quelques vaches Ă l’extĂ©rieur du camp. Elles ont des veaux, donc on arrive Ă avoir un peu de lait comme ça. On en prend juste un petit peu quand on en a besoin. Bon sinon, tu veux quoi ? — CafĂ©, ça ira merci ! — Tu ne manges pas ? — Pas le matin, pas l’habitude ! — Ah ok.
Thomas dégote une tasse dans un des vieux placards brinquebalant qui forment un semblant de cuisine, puis se dirige derrière moi, vers l’âtre d’une cheminée de pierre construite à coup sûr de la main de son père. Un léger brasier s’agite encore au-dessus d’un récipient de métal fumant dans lequel il plonge la tasse. Revenu à ma hauteur, il la dépose bruyamment sur la table en bois, laissant les odeurs aigres, amers, légèrement acides et douces du café brulant exciter mes narines. Mon cerveau me crie automatiquement « manque ». Mon addiction à la caféine guettait depuis deux semaines. J’en prend une gorgée. Le feu me gagne, des gencives, jusqu’à mon estomac, suivant la trajectoire du liquide s’étendant comme de la lave en fusion au travers de mon organisme qui se réveille totalement d’un coup. Je secoue la tête et reprend directement une autre lampée. C’est fort, c’est même trop fort, mais alors, que c’est bon. Un vrai café bien noir comme je les aime.
— Merci, ça faisait longtemps ! dĂ©clare-je en exhalant. — Pas de quoi ! Te brĂ»le pas non plus. — T’inquiète pas, c’est de l’acier en dedans, ça ne craint plus les brĂ»lures. — Va dire ça Ă ta jambe tiens ! — Toi tu me cherches vraiment ! rĂ©pond-je en reprenant un peu de cafĂ©. — Moi ? Jamais ! — Mouais… au fait ! Question bĂŞte que je me pose, pourquoi deux lits dans ta chambre ? Une gĂŞne s’installe, et il se dĂ©tourne de moi. Il se dirige vers la porte qui donne sur l’extĂ©rieur. — Allez, termine ton cafĂ©. Me dit-il d’une voix lĂ©gèrement chevrotante. Mon père doit attendre. Je me dĂ©cide Ă ne pas insister et j’avale rapidement les quelques gorgĂ©es qui me sĂ©parent du fond de la tasse. — VoilĂ , j’suis prĂŞt. Tu sais oĂą il est ? — Oui. Aux portes ? — Aux portes ? — Celles qui donnent sur l’extĂ©rieur. Faut bien chasser ceux qui t’ont fait du mal. — Il a besoin de moi pour ça ? — Ça a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© ainsi. Selon lui, assister au châtiment, c’est une façon de dissuader les autres de faire des conneries. Puis, je suppose que ça doit foutre la honte aux bannis, surtout si leur victime les regarde se faire punir. — C’est correct. — Ouais. Bon allez viens maintenant !
Et nous voilà parti à traverser les petites rues et les places. Le soleil est radieux et en effet déjà haut dans le ciel. Tout est silencieux, aucune animation dans ce petit village pourtant si bruyant depuis que j’y suis arrivé. Vide, tout était vide, pas âme qui vive, si ce n’est quelques chats et un chien de ci de là qui s’occupant de leurs affaires. De notre point de vue, les remparts sont à peine visibles. En vérité, ceux-ci sont à peine d’un ou deux mètres plus haut que les habitations selon les endroits. Pas un nuage dans le ciel et des volutes de poussière qui s’échappent à notre passage. Thomas court bien plus vite que moi et finit par s’en apercevoir. Je boitille de mon côté, en marchant vite. Les bandages sur ma jambe ont été resserrés et cette culotte de fortune qu’on m’a mis me gêne. Puis, j’ai encore cette douleur… Au détour d’une ruelle, entre deux maisonnées, les grandes potes encore closes nous apparaissent. Il y a bien du monde autour. Tout le village me semble-t-il. Certains sont même montés sur des échafaudages de fortune afin de ne rien manquer du spectacle. Nous continuons d’avancer, en marchant cette fois-ci. Le père de Thomas se tient juste au-devant du rempart. Blond, à l’allure svelte mais ne manquant pas de musculature et au visage carré, de sa haute stature, il domine les deux éphèbes démoniaques qui se retrouvent à genoux, poings liés dans le dos, mis en joue par deux hommes armées à leur côté. Le fier berger allemand se tient à côté de son maître, semblant prêt à mordre s’il le faut.
— Viens, Nicolas ! Approche-toi ! Me lance le grand homme en me faisant un signe de la main.
L’esprit inquiet et hésitant, je m’exécute, faisant mine de ne pas être impressionné. Pourtant, c’est bien tout l’inverse qui se traduit dans mon cerveau. Je sens les regards autour de moi. Thomas est resté en arrière. A nouveau, un silence de messe semble avoir étendu son voile transparent sur la population. Seuls quelques piafs portés par un léger vent trahissent cet atmosphère oppressante. J’arrive finalement à la hauteur du père de Thomas. Il me surplombe d’une bonne tête et demie. Son chien ne prête même pas attention à ma présence, il reste fixé sur les deux abominables qui eux me regardent d’un œil noir.
— Mesdames, messieurs. Il est dur, pour moi, comme pour vous de convenir Ă dĂ©cider du sort de nos concitoyens ! Commence-t-il. Qui sommes-nous pour traduire deux hommes devant une justice dĂ©sĂ©quilibrĂ©e, chancelante, quasiment inexistante ? Je vous le demande, qui sommes-nous ? Silence de mort. — Sans doute personne, et vous en conviendrez surement ! Je ne tiens Ă parler au nom de personne et je n’ai pas choisi la place que l’on m’accorde dĂ©sormais. Mais, puisque tel est mon sort maintenant, et jusqu’à ce qu’il en soit dĂ©cidĂ© autrement, il me faut assumer aussi la fonction de bourreau. Ce mot vous semble violent ? Il l’est. Pas un bruit. — Des tâches que vous m’imposez d’effectuer, c’est probablement celle-ci qui me coĂ»te le plus ! Mais, puisqu’il le faut. Je m’exĂ©cute. Ces deux messieurs on fait preuve d’un comportement vĂ©ritablement abject, menaçant le bien ĂŞtre de toute la communautĂ©. Et si nous les laissons en nos seins, qui nous dira qu’ils ne feront pas d’autres victimes, qu’ils n’iront pas plus loin dans leurs actes cruels et abominables ? Qui ? Personne ! Qui d’entre vous se porterait garant de ces deux monstres ? Qui ? Aucune rĂ©ponse. — Personne ? Alors votre sort est scellĂ© messieurs ! dĂ©clare-t-il en posant ses yeux sur les deux hommes sveltes toujours agenouillĂ©s. Et parce que je ne m’estime pas ĂŞtre en droit de dĂ©cider de votre vie ou de votre mort, vous allez ĂŞtre bannis. DĂ©finitivement ! Une douce clameur commence Ă monter depuis le public. — Par l’abus, vous avez mĂ©ritĂ© de ne plus avoir de toit ! Par votre indignitĂ©, nous ne pouvons plus vous considĂ©rer comme faisant partie des nĂ´tres ! A chaque phrase, la clameur monte de plus en plus, se transformant en un chĹ“ur d’hommes, de femmes et d’enfants avalisant les mots de l’homme. — Par l’infamie dont vous avez fait preuve, et non pas Ă une seule reprise, vous ne mĂ©ritez plus de garder toute possession de vos biens ! Et par votre ignominie, vous ne pouvez prĂ©tendre Ă ĂŞtre libre de vos mouvements ! La foule est en liesse. — De ce fait, et avec l’accord de Nicolas, vous serez bannis de la communautĂ©. Vous allez donc ĂŞtre conduit, poings liĂ©s, et yeux bandĂ©s dans un lieu que vous ne pourrez reconnaitre. Vous n’aurez plus de bien, ni mobilier, ni nourriture. Vous allez ĂŞtre remis Ă zĂ©ro. A vous de trouver une autre communautĂ© qui souhaitera vous accueillir ! Si seulement vous parveniez Ă en trouver une ! Il se tourne vers moi. — Avalises-tu la sentence ? As-tu quelque chose Ă ajouter ? Je le regarde dans les yeux. Il m’impressionne, je n’ose parler. Je me tourne alors vers les affreux, ceux-ci semblant me maudire du regard. Marc laissant Ă©chapper sa langue bifide entre ses lèvres fait frĂ©mir l’assemblĂ©e. Des cris de surprises rĂ©sonnent. Ne parvenant Ă ouvrir la bouche, j’acquiesce simplement. — Messieurs ! les bandeaux ! dĂ©clare le père de Thomas Ă l’intention des deux hommes qui tiennent leurs fusils.
Les yeux bandés, les poings toujours noués, les deux garçons sont mis debout et dirigés vers la porte sous les hués de l’assemblée. Trois hommes soulèvent un large et épais morceau de bois retenant les battants, avant que deux autres n’actionnent des cordes, libérant l’accès vers l’extérieur. Un extérieur nu, fait d’herbes s’étendant à perte de vue. Un vide comparable à une toile blanche. Un vide effrayant. Alors que les portes se referment, un bruit de moteur s’élève dans l’air, avant de s’éloigner, puis de disparaître au loin. Les deux tortionnaires, Arnaud et Marc étaient partis pour toujours. Tout était allé si vite. Je ne comprends pas encore tout ce qui m’arrive. A peine je pénètre en ce lieu que me voici victime, puis décisionnaire du sort de mes bourreaux. Je crois que je me suis laissé aller. J’aurais dû rester sur mes gardes, comme depuis l’apocalypse. Si j’avais réussi à survivre seul jusque-là , c’était bien parce que je me méfiais de tout, tout le temps, n’importe où. Qu’est ce que je fous à être aussi con… Une main massive se pose sur mon épaule.
— Nous n’avons pas encore eu l’honneur de vraiment nous prĂ©senter tous les deux ! Me dis le père de Thomas de sa voix si pĂ©nĂ©trante. Éric, heureux de te connaitre ! Il me tend une main. HĂ©sitant, je lui serre maladroitement. — Nicolas, mais vous le savez dĂ©jĂ . — Mon fils m’a parlĂ© de votre rencontre ! Je n’ose pas rĂ©pondre. — As-tu pu passer une bonne nuit ? — Oui ça va ! M… merci ! — Très bien. Bon, fais attention dĂ©sormais ! Notre mĂ©decin va peut-ĂŞtre commencer Ă se sentir lĂ©ser Ă devoir Ă chaque fois intervenir auprès de toi ! Et voilĂ , je me sens encore plus con maintenant. — Bah… promis ! Dis-je, ne sachant pas trop quoi lui rĂ©pondre. — très bien ! Tu peux rester dormir Ă la maison pour le moment. — C’est … Gentil ! — Y a pas de quoi (il me tape le dos), Thomas semble bien t’apprĂ©cier ! Ce qui est vraiment Ă©trange dans cette situation, c’est de voir un homme sans doute pas vraiment beaucoup plus âgĂ© que moi me parler de la relation naissante entre son fils de 15 ans et moi. Bienvenue en absurdie. A quoi s’attendre alors que tous les repères se sont envolĂ©s d’un coup ?
La vie suit son cours depuis le départ d’Arnaud et Marc. Cela fait maintenant plusieurs mois que je suis dans le camp. Je suis toujours hébergé chez Éric et Thomas et tout se passe pour le mieux. J’aide, je participe. Un coup de main par-ci, une expédition par là . Éric commence à vraiment prendre son rôle de chef de la communauté vraiment à cœur. Des réunions entre citoyens s’organisent toutes les semaines et tous ont le droit d’y aller de leurs idées, de leur propositions. La vie au village s’organise comme elle le peut, mais les habitations deviennent de moins en moins spartiate. Ce n’est jamais le grand luxe, mais au fil des raids dans les villes abandonnées, chacun y va de sa récupération afin d’améliorer son confort. L’entraide est un point central de la vie ici. On a même commencé à élaborer des cultures sous serre. L’hiver a pris place depuis quelques temps et le printemps va bientôt réchauffer l’atmosphère. Mais qu’il est bon de manger des soupes et autres ragout de pommes de terre ou de poireaux issus de nos terres. Hommes et femmes chassent même désormais. Moi qui avais adopté un régime végétarien depuis 3 ans, je ne rechigne pas à m’accorder un morceau de gibier de temps à autre. Nous vivons dans notre propre utopie, et c’est agréable. Deux frères, Jérôme et Mickaël, avaient rapporté de nouvelles radios en décembre qu’ils ont réussi comme, avec les autres, à raccorder à un générateur tout proche. Depuis, ils passent le plus clair de leur temps à chercher une transmission. Opération sans doute vaine, mais sait-on jamais.
Ce soir, Mars venait d’arriver. Thomas garde un calendrier qu’il dissimule sous son lit et y marque d’une croix chaque jour entamé. Nous nous sommes couchés tôt tous les deux. Son père est resté dans la pièce à vivre avec le chien et le chat se balade tranquillement entre nos deux lits. Par miracle, les deux animaux se tolèrent, mais on sent très clairement qu’il ne faudrait pas que l’un et l’autre ne pénètrent trop longtemps sur leurs territoires respectifs. J’ai pu retirer cette couche éphémère qui me couvrait à mi-corps. Depuis plusieurs semaines, je peux observer à chaque fois que je me lave les effets de ma mauvaise rencontre. Les cicatrices sont bien visibles et me valent des hauts le cœur à chaque fois que je pose les yeux dessus. Ils ne m’ont pas raté, je suis entaillé, comme découpé du haut des cuisses jusqu’au nombril. Pendant un temps, j’ai pensé y voir des marques de dents. Cette idée m’horrifiait tellement, que j’essayais de me convaincre que je délirais.
— J’y pense ! Commence Thomas en reposant le livre qu’il lisait sur son torse. Tu as Ă©chappĂ© deux fois Ă la mort depuis la catastrophe. — Heu… oui. RĂ©pond-je simplement, surpris. — Ta jambe, puis les deux autres lĂ . — Comme je te l’ai dĂ©jĂ dit, depuis ma naissance ma vie ne tient qu’à un fil. — Tu as eu d’autres expĂ©riences du genre ? — Ouais, plus ou moins volontaires. — Ah ? Tu veux en parler ? — Oh, sans vouloir te vexer, je prĂ©fère Ă©viter. — T’inquiète, je comprends. Un silence s’installe. — Tu sais moi, avec mon problème, on a toujours fait un peu trop attention Ă moi. J’ai jamais rien vĂ©cu de vraiment extraordinaire. A part, ce qu’on a tous vĂ©cu l’an dernier. Heureusement que j’avais mon père… — Tu avais cette chance lĂ , et tu l’as encore… — J’avoue ouais ! — T’es sĂ»r que ça va ? — Hein ? Oui, oui, t’inquiète, tout va…
Une voix qui s’interpose. Quelqu’un a pénétré dans la baraque. On entend Éric qui répond. Les deux hommes se parlent, fort.
— Il se passe quoi lĂ ? demande-je ahurit. — J’sais pas, autant aller voir.
Laissant le chat à ses occupations, nous nous dirigeons vers l’autre pièce. Soulevant le drap qui nous obstrue la vue, nous finissons par voir Éric, debout devant la table, le chien à ses côté et face à eux, Jérôme qui venait de pénétrer le pas de l’entrée.
— C’est toujours en cours ? Demande le grand homme. — Oui, oui, il faut que vous veniez voir ? — Je te suis ! — Qu’est-ce qui se passe ? Interroge Thomas. — Venez ! Lui dit son père.
Pas le temps de se rhabiller chaudement, nous nous faufilons vers l’extérieur, pénétrant dans la nuit et le froid de l’hiver s’achevant. Sous le vent glacial, nous traversons quelques rues désertes, avant de nous retrouver devant une cabane éclairée de l’intérieur à la bougie. Plusieurs personnes sont amassées devant la porte ouverte, grelotantes, emmitouflées dans des doudounes ou des couettes. Tous nous laissent le passage, nous révélant le son grésillant d’une voix d’homme. La radio posée sur une simple table laissait échapper les mots d’un appel :
« … temps de laisser derrière nous… désaccords ! … re au rassemblement ! … temps pour tout hommes, femmes et… fants de se… unir autour d’une cause commune… » Nous écoutons, à la lueur des petites flammèches. Personne ne pipe mot.
« … idéaux ne sont plus… unautés sépa… tistes… tombées ! … réunification est LA solution ! … ceux qui m’entendent, … Joignez nous afin de… struire un nouveau m… de, un monde meilleur ! … cun trouvera sa place ! … sons la paix, entre tous ! … avons des tas de choses à discuter… ppelle à tous ceux qui m’entendent de… nir ! Nous sommes… tilly ! … épète… Chant… lly ! … message tournera sur les ondes… longtemps qu’il… ra permis ! … nez ! »
Puis, le message laisse place à des chœurs reprenant l’hymne à la joie de Beethoven.
— Ai-je bien entendu ? Il a dit Chantilly ! DĂ©clare Éric. L’énoncĂ© de cette ville me fait presque vaciller sur mes jambes. L’image de ma sĹ“ur, mes nièces et mon neveu s’épand dans ma tĂŞte, dans mes souvenirs. Ce n’est pas le moment. Stop ! — C’est ce qu’il me semble oui ! — C’est Ă seulement 40 kilomètres d’ici. La ville aurait-elle Ă©tĂ© Ă©pargnĂ©e ? — J’en sais rien. — On a un nom ? — Il dit s’appeler Emilien Constant ! — Emi… Attends, ça me dit un truc ce nom là … — La tĂŞte de file des « Nouveaux penseurs » ! L’interrompe-je. — Mais oui, c’est ça. Merci ! — Je devais me rendre Ă une de ses confĂ©rences… mais… enfin bref, c’est assez hallucinant qu’il soit encore en vie. — Je l’aimais bien ce type ! Avoue Thomas. — Oui, je m’en souviens fiston. — Qu’est-ce qu’on fait Éric ? l’interroge JĂ©rĂ´me. — Je ne sais pas. Nous ne pouvons rĂ©pondre Ă ce message. Il va falloir rĂ©flĂ©chir… — Il faudrait faire une rĂ©union ! Reprend Thomas. C’est important. C’est pas rien de pouvoir peut-ĂŞtre trouver d’autres personnes… — Il faut y rĂ©flĂ©chir !
La nuit fut agitée. Je n’ai pas arrêté de ressasser le message radio. De plus, nous sommes restés assez longtemps à veiller chez Éric et Thomas avec des gens du village à discuter de ce qui arrivait. Le café avait tourné et tout le monde avaient rejoint très tard ses pénates. Je n’ai pu m’empêcher de rêver de ma sœur et ses enfants. Les rêves sont durs à contrôler et même si je le voulais, je pense être psychiquement trop faible pour y parvenir. Je ne dois pas espérer !
Afin de réunir tout le village, un siège avait été installé sur une petite estrade sur la plus grande des places. L’après midi faisait son œuvre, mais le froid régnait encore sous le couvert nuageux du nord. Il semble qu’une tempête ne va pas tarder à se lever. Le vent commence à siffler. Éric trône sur l’estrade, accompagné du chien, face au peuple.
— Bon, vous savez tout maintenant ! Vous savez aussi ce qu’il vous reste Ă faire ! (il s’exprime d’une voix claire et bien audible). Faut-il rester ici ? Vivre dans notre petit monde en ignorant ce qui se passe Ă l’extĂ©rieur, en ne sachant rien des dangers ou des espoirs qui nous guettent ! Ou, devons-nous partir, au risque d’être confrontĂ© Ă l’inconnu ? Je ne peux pas prendre cette dĂ©cision seul. Vous ĂŞtes cette communautĂ©, Ă vous donc de donner votre avis en votre âme et conscience, de peser le pour ou le contre ! Je vous laisse le temps de la rĂ©flexion ! j’attends ici votre rĂ©ponse ! Que ceux qui souhaiteront partir me le fasse savoir de leur main droite levĂ©e !
Éric s’assoie. Un silence de mort brisé par le vent qui arrive en bourrasque s’est installé. Chacun semble réfléchir pesamment, des yeux sont levés au ciel, tandis que d’autres semblent regarder leurs chaussures. La chose est véritablement prise au sérieux et plusieurs minutes se sont déjà écoulées sans que personne n’eut bougé. Je commence à me dire que personne ne voudra partir. Je lance un regard incertain à Thomas, mais lui-même semble absorbé. Un coup de tonnerre dans le lointain. La tempête fait son chemin. Je scrute la foule, rien. Rien durant encore d’interminables minutes. Puis, une main se tend timidement vers le haut, suivi quelques instants plus tard par une autre, puis une autre, et une autre. Au bout d’un long moment, la quasi-totalité de la centaine de personnes présentes tiennent leur main droite au-dessus de leur tête. Et alors que la pluie commence à s’abattre sur les crânes, les vêtements, le bois et la terre sèche, Éric se lève, les bras écartés.
— Mes amis ! Il semble que vous ayez parlĂ© !
Il avait suffit de seulement quelques jours pour que chacun rassemble ce qu’il pouvait. De quoi se nourrir, s’abriter quelque peu, se vêtir. Nous sommes partis un matin, abandonnant derrière nous cet espace de vie qui, pour ma part, avait été un « home sweet home ». Un havre de paix de plusieurs mois après les effroyables moments qui avaient endeuillé le monde. Nous traversons plaines et forêts, privilégiant le couvert des arbres pour passer nos nuits. Des feux étaient allumés le soir, puis éteints au petit matin. Des tours de garde sont organisés alors qu’il fait noir. Les rumeurs de dinosaures échappés se faisant de plus en plus présentes dans les esprits. Nous marchons lentement, Éric ne souhaitant abandonner personne. En réalité, il nous aurait sans doute fallu 2 ou 3 jours maximum pour atteindre Chantilly, dans de bonnes conditions physiques. Mais tout le monde n’a pas la santé, et c’est sans compter les vaches et veaux que nous avions décidé de garder avec nous, ainsi que les quelques giboulés qui nous surprennent de temps à autre, nous obligeant à nous protéger des grêlons. En 3 jours, nous n’avons finalement atteint que la moitié du chemin. Selon Éric. Deux éclaireurs étaient partis à cheval un jour plus tôt. Cette troisième nuit, je me suis allongé au pied d’un sapin. Il y en a quelques-uns dans nos forêts, tout comme des pins. Sous les larges branches étalant leurs épines, je me sens comme protégé. L’écorce torturée me va bien et même le chat semble trouver son compte dans son lit d’aiguilles séchées. J’ai fini par occulter l’horreur de la catastrophe de la fin de l’été. Je n’ai pas oublié ma famille, ni mes amis, mais je me suis fait une raison. Comment faire autrement ? Je suis entouré d’Éric, Thomas, du chien et d’autres personnes autour d’un des feux dont les ombres rougeoyantes semblent embraser toute la forêt. J’ai du mal à trouver le sommeil, alors je contemple les flammes en écoutant les chants du bois. Le concerto de branches qui craquent, qui s’effleurent, de feuilles qui bruissent les unes contre les autres, batraciens et autres oiseaux de nuit chantant, tout ceci est beau à écouter. La nature est maîtresse en ces lieux. Loin de la pensée humaine, des bruits des villes qui n’existaient probablement plus, des avions qui ne revoleraient jamais. L’air semblait être devenu bien plus facile à respirer ces derniers mois. Partout où nous avons marché, la végétation reprenait peu à peu ses droits et il n’était pas rare de croiser biches et autre sangliers au détours d’habitations inoccupées. L’apaisement me gagne et je finis par fermer les yeux. Ma sœurs, mes nièces, mon neveu… Ils sont là , autour de moi. Ils rient, s’amusent, semblent me parler… Un sifflement soudain et un son mat dans l’écorce juste à côté de mon oreille gauche. Je sursaute et laisse échapper un cri qui réveille les autres. Tous se mettent en alerte sur leur séant, prenant leurs armes en main pour ceux qui en ont. Tournant la tête, je vois à quelques centimètres de moi, à la lueur des flammes, un trait en bois enfoncé dans le tronc. Je suis pris de sueur. Les autres l’ont vu aussi. Éric donne l’alerte.
— Prenez vos torches ! Trouvez-moi celui qui a fait ça ! Ordonne-t-il.
Des hommes s’élancent à travers le bois, éclairant l’obscurité sur leur passage.
— Tu vas bien ? Me demande Éric en arrivant Ă ma hauteur, posant sa main rassurante sur mon Ă©paule. — Je crois oui ! — J’ai l’impression qu’on t’en veut ! me dit-il en grognant, observant, puis dĂ©gageant la flèche taillĂ©e. — Tu penses que c’est… — Je n’en sais rien. Mais si nous les trouvons, ils paieront !
Je sens la rage l’enflammer. Une rage mêlée d’une crainte à peine perceptible. La crainte de mettre en danger sa communauté, son fils. Mais il ne défaille pas. Se relevant, je le vois observer dans les multiples directions qu’avaient pris ses hommes. Des pointillés lumineux se meuvent de part et d’autre de la forêt. Cette danse des feux dure depuis plusieurs dizaines de minutes quand les hommes finissent par revenir.
— Rien, on n’a rien trouvĂ© Éric. MĂŞme nos gars qui Ă©taient de garde n’ont rien remarquĂ© ! — Bon ! Nous allons rester Ă©veillĂ©s cette nuit messieurs. Laissons les femmes et les enfants se reposer. Restez aux aguets, au moindre bruit suspect, n’hĂ©sitez pas Ă intervenir ! — Très bien Éric !
Tous finissent par rejoindre leur famille et la nuit se passe plus calmement, Éric veillant sur Thomas et moi. Je ne peux dormir que d’un œil.
La marche est plus tendue ce matin. La nervosité est palpable et les armes sont de sortie. Les regards se font insistant sur les alentours de la forêt. Éric est en tête du cortège, Thomas et moi à sa suite. J’ai 34 ans et j’ai l’impression d’être un môme. Estropié, faible, je me rend compte que me battre risquerait d’être compliqué. Alors que nous arrivons à l’orée de la forêt, un bruissement dans les fourrés juste devant nous stoppe notre avancée. Le chien se met à grogner et Éric est obligé de tenir fermement la laisse. Deux hommes se positionne sur ses flancs, fusil au poing. Même le chat commence à s’exciter dans son sac. Je le sens dans mon dos. C’est alors qu’une tête blanche, allongée et velue fait son apparition. Déplacement irréel et fantomatique d’un être inconnu depuis longtemps dans nos contrées. Le chien continue à gronder alors que l’animal aux oreilles dressées nous fixe de sont regard noir et profond, arrêtant sa marche gracieuse.
— Un loup ! s’échappe comme un murmure de ma bouche. — Trop beau, il est magnifique ! enchĂ©rit Thomas. La foule exhale d’étonnement et de frayeur mĂŞlĂ©s. — Qu’est-ce qu’il fait lĂ ? Interroge l’adolescent. — Je suppose que lui aussi s’est Ă©chappĂ©. — Mais pourquoi remonter jusqu’ici ? — Il y a peut-ĂŞtre Ă©tĂ© contraint. — Comment ça ? — Des prĂ©dateurs plus gros ont dĂ» l’obliger Ă trouver un autre endroit pour subsister… — Oh, je vois. Frissonne Thomas. La bĂŞte majestueuse continue Ă nous observer sans bouger. Gueule ouverte, langue pendante. — Qu’est-ce qu’il se dit Ă ton avis ? — Si je le savais. Tu as vu ses yeux ? C’est un animal intelligent, très sensible ! Il ne nous veut certainement aucun mal. Il se demande surement la mĂŞme chose que nous. Qu’est-ce que ce troupeau de bipèdes fait ici ? Qu’est-il arrivĂ© pour que les semblables de ceux qu’il a dĂ» connaitre auparavant se retrouvent dans cette galère, vĂŞtus de aillons, sales, apeurĂ©s. Peut-ĂŞtre a-t-il pitiĂ©. Peut-ĂŞtre pas. Peut-ĂŞtre est-il cynique et se dit-il « bien fait » ! Que deviner dans ces yeux-lĂ ? En tout cas, il semble qu’on l’intrigue. C’est curieux un loup et pas aussi dangereux qu’on veut bien le penser. Il ne se demande pas lequel d’entre-nous il souhaiterait dĂ©vorer. Du moins je l’espère.
Un aboiement du chien fait disparaitre le loup. Telle une ombre n’ayant jamais été. Un mirage. Un instant plus tard, nous passons la lisière. Les hommes à cheval arrivent au loin, alors que nous nous retrouvons à l’entrée d’une petite ville désertée. Un panneau indique « Pontarmé ». Village de mon enfance. De mes vacances d’enfance. Nous avons donc passé Senlis. Chantilly n’était à notre portée, toute proche. La ville s’articule autour d’un axe centrale, se dirigeant tout droit en direction de Paris. Une longue succession d’habitations, boulangeries et autre concession automobile. Endroit que je ne connaissais que trop. Mais, je ne souhaite toujours pas revenir dans le passé. Je préfère ne pas regarder et continuer à suivre l’asphalte en regardant droit devant moi. A un moment, nous prenons à droite afin de prendre la direction de notre destination finale.
— Nous pouvons y arriver Ă l’aurore ! Affirme Éric Ă l’intention de tous. Courage, nous touchons au but.
Nous continuons à marcher tous le reste du jour, traversant un minuscule village vide traversé d’un ruisseau. Nous restons sur la route, longeant une nouvelle fois la forêt.
— Je me rappelle, une fois j’ai failli tomber d’un arbre ! Me raconte Thomas. — Toi qui Ă©tais si bien protĂ©gĂ© ? — Oui bah cette fois, c’est moi qui ai fait le couillon en Ă©chappant au regard de mes parents. J’étais petit et j’en avais marre d’être continuellement couvĂ©, alors bah j’ai grimpĂ© pour me sentir libre. Et j’ai dĂ©rapĂ©. Ma cheville s’est retrouvĂ©e coincĂ©e dans un nĹ“ud. Mon père a dĂ» venir me dĂ©crocher. Je me suis bien fait engueuler ce jour-lĂ . — Bien jouĂ© ! (je ri). Moi j’ai bien cru mourir une fois en tombant d’un arbre. — Sans blague, non mais t’arrĂŞte pas toi en fait ! — Faut croire ouais ! — Raconte ! — Rien de fameux en vĂ©ritĂ©. On avait eu l’idĂ©e de grimper Ă un arbre avec nos rollers aux pieds avec ma sĹ“ur… (La mentionner me met mal Ă l’aise, quelque chose s’effondre en moi, mais je ne flĂ©chis pas), et… arrivĂ©s au sommet, comme une conne, elle m’a poussĂ©, (Thomas ouvre de grands yeux), et puis bah je suis tombĂ© sur le ventre, le bras droit sous le ventre. J’ai cru ne plus jamais pouvoir respirer de ma vie. — T’as une sacrĂ©e sĹ“ur toi ! — Eh ouais. Elle vit ou vivait… Je ne sais pas… enfin, lĂ oĂą nous allons ! — A Chantilly ? — Oui. — Tu espères la retrouver ? — J’en sais rien, pas envie de me faire de faux espoirs… — Arf, ouais je comprends.
La suite du voyage se passe dans le silence. On n’entend que le souffle des gens qui souffrent à marcher depuis des jours. Je pense que chacun à hâte d’arriver. Moi aussi. Même si, je n’ai aucune envie d’être déçu en arrivant là -bas. Je ne veux pas m’imaginer une montagne de bonnes choses, dont ferait partie ma sœur et sa petite famille. Je n’ai aucun désir de m’imaginer qu’ils aient pu survivre. Mais si seulement… Non, je ne dois pas y penser. Je m’y refuse !
Le soleil bas sur l’Horizon, nous débouchons au détour d’un rond-point. Le sol est pavé, la vue est dégagée. Je reconnais l’endroit. Non loin, à l’est s’étendent les grilles clôturant le parc, le château magnifique et toujours debout en son sein. Une sorte de camp de base est installé au-devant de l’accès au parc et des hommes en treillis arpentent les lieux. Une parabole se tient au-dessus, pointant vers le ciel s’obscurcissant peu à peu. Les ombres gagnant le parc et ses environs, le groupe, guidé par Éric, se dirige à la rencontre des hommes qui nous ont aperçu. Tous regroupés, droits comme des I, ils attendent. La descente semble durer une éternité tant la fatigue est présente. Je tiens Thomas par l’épaule.
— Bienvenue Ă Chantilly ! nous lance solennellement un homme en bĂ©ret, s’avançant Ă notre rencontre, pointant sa main ouverte en direction d’Éric. — Merci bien ! fait l’homme en l’empoignant vigoureusement. — Vous ĂŞtes le chef ? — On peut dire ça. — Bien, le voyage s’est bien passĂ©, pas de perte ? — Tout va bien, nous avons marchĂ© quelques jours. — D’oĂą venez-vous ? — Du cĂ´tĂ© de Compiègne. — Pourriez-vous me donner votre nom s’il vous plait ? Demande un autre homme Ă©crivant sur un carnet. — Éric ! — Éric, très bien, nous allons prendre vos identitĂ©s, simple formalitĂ©, puis nous vous prĂ©senterons Ă Emilien !
Cette histoire fait partie d'un tout plus grand !
|














