




Contraintes aléatoires Contraintes à sélectionner soi-même Testeur d'auxiliaire Situations aléatoires (défi de Schrödinger) Textes sans commentaires Générateur de situation/synopsis 
À la manière du western

Elbaronsaurus
Spectacles
Elbaronsaurus Timeline
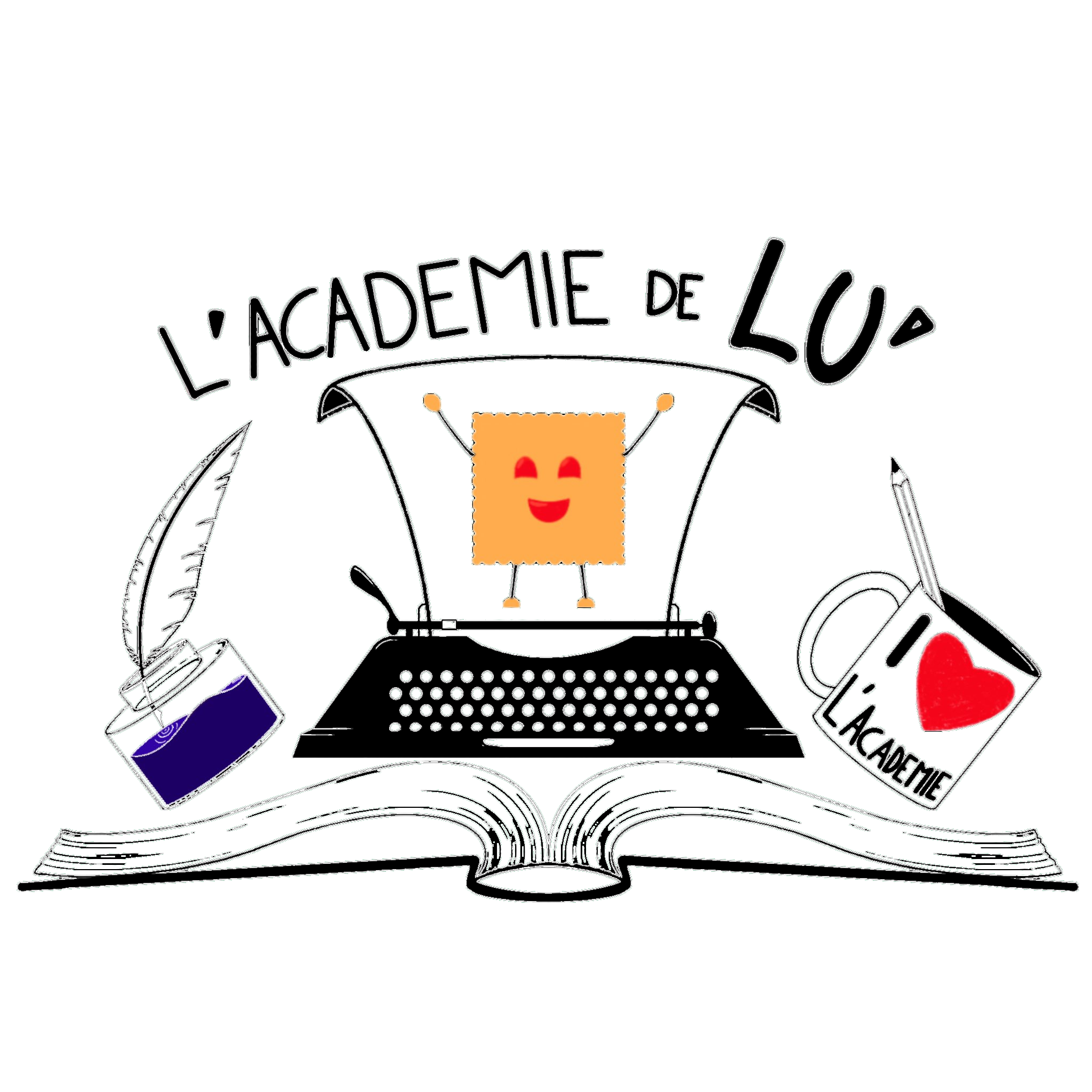  Danse avec les fous(par Elbaronsaurus)Ça fait deux semaines que tout est tombé. L’effondrement tant redouté, souvent raillé, pourtant prédit est survenu. Et il n’a fallu que deux semaines pour tout voir partir en fumée. Après les premières attaques, ce qui dormait profondément dans les cités s’est réveillé. Violemment, douloureusement, cruellement, les songes de certains se sont transmis telle une trainée de poudre dans les esprits fragiles, conférant à la réalité un goût de sang, de métal et d’explosif. Il n’aura fallu que deux semaines pour faire de moi un exilé dans ma propre ville. Je ne suis plus qu’un homme vêtu de haillons, parcourant les rues, traversant les bois, visitant les villages alentours afin de trouver de quoi subsister, tant que personne ne m’a encore trouvé. Je marche, il me semble que je ne fais que ça. Ces quinze jours, si tant est qu’ils soient vraiment quinze, me semblent déjà une éternité, alors que je sais pertinemment que si je survie assez longtemps, ces jours ne seront que broutilles. J’ai été pris dans les combats un matin, sans comprendre ni pourquoi ni comment, mais j’ai été blessé, juste en bas de chez moi. Un cocktail Molotov projeté en pleine confusion aura suffit à brûler ma jambe droite au 2eme degré. Ne comptant pas sur les services hospitaliers, qui dans mon esprit ne devaient logiquement ne plus avoir aucune espèce d’importance, je me suis glissé lentement, dans le silence que mes gémissements me permettaient, à l’écoute des cris d’affolement de mes voisins, jusque dans mon appartement et j’ai laissé ma jambe tremper dans un bain d’eau glacée, avant de la langer, dans de vieux t-shirt que j’ai beaucoup trop serré afin de contenir comme je le pouvais une possible hémorragie. Les nuits et les jours qui ont suivi ont été rythmés par les cris et les explosions, les sirènes des différents corps armées et les semonces religieuses proférées par nos persécutants. Toutes ses choses se bousculaient se brouillaient dans l’esprit malade et fiévreux qui me clouait au lit. Il m’aura fallut aumoins cinq jours, rien n’est moins sûr, pour recouvrer un état de quasi pleine conscience. Mon corps venait de survivre à l’attaque des microorganismes qui s’étaient infiltrés en moi de par ma peau carbonisée et déchirée, quasi dissoute à certains endroits de ma jambe. L’infection aurait pu me faire passer l’arme à gauche, mais j’ai finalement réussi à me sortir de là . Mon arme est désormais à ma droite. Je n’avais pas nourri le chat durant ces jours fait d’illusions, d’hallucinations, de transpiration et autres fluides corporels déversés dans mes draps, hors de tout contrôle. Mais, à mon réveil, elle était là , assoupie sur le lit, contre le mur concomitant à la salle de bain. Elle avait maigri en quelques jours. Comme moi, elle avait survécu à l’épreuve due à un vulgaire projectile enflammé. L’esprit encore confondu dans une semi-torpeur inconsciente, je m’étais levé afin d’abreuvé et nourrir ce petit animal qui bien que délaissé, avait choisi de me tenir compagnie jusqu’au bout. Malgré ma jambe chancelante, encore recouverte de lambeaux rougeâtres tirant sur des notes cramoisies et parfois presque noires, j’ai pu faire les quelques pas qui me menèrent à la cuisine. Le chat se trouvait dans un état non moins désastreux. Je lui ai donc, pour une fois, amené à boire et à manger directement sur le lit. La laissant reprendre des forces, quelque chose attira mon attention. Les bruits de combat et les cris de frayeur avaient cessé et il m’avait fallu un certain temps pour finalement m’en rendre compte. Me dirigeant vers la fenêtre, je ne vis que désolations, bâtiments éventrés et encore fumant d’incendies qui n’avaient dû cesser que grâce à la pluie qui était tombée récemment. Le sol encore humide, ponctué par endroits de flaques, avait été troué, défoncé, détruit. Les trottoirs et la route de bitume n’existaient presque plus, comme labourés par une machine agricole gigantesque qui aurait terrassé tout ce qui faisait de ce petit quartier commerçant, l’un des poumons économiques et sociales de la ville. Seuls les croassements des corbeaux freux et des corneilles réunies en une masse noires et grouillantes résonnaient, se répondant en écho. Les oiseaux étaient afférés à soulever, décortiquer, mâchonner, griffer les dizaines de corps étaléssur le sol, au bord des fenêtres explosées, projetés dans les quelques amas végétaux qui subsistaient encore. Les cadavres pulvérisés et décharnés servaient de festin inopiné à ces animaux, qui, patiemment ont dû attendre que nous finissions par nous entretuer. Au milieu des plumages noirs iridescent bleu et vert, se faufilaient quelques renard. Il me sembla apercevoir un blaireau pénétrer dans ce qui était un par terre de fleurs, avant qu’il ne soit ravagé. Des chiens aboyaient au loin, du côté de l’aile sud d’une grande bâtisse d’architecture 19eme à moitié écroulée sur ma gauche. Une nuée d’oiseaux aux mœurs opportunistes s’étaient envolés après que les clébards eut sûrement voulu leur subtiliser leur pique-nique.
Voilà dans quel monde je vis depuis deux semaines. J’ai pris le chat avec moi. Je n’avais rien pour le transporter de manière sécuritaire, alors, la première chose que j’ai fait – au-delà de récupérer de quoi me défendre sur des corps sans vie, outrepassant des hauts le cœur et des pleures occasionnés par la vision des organes jaillissant des cages thoraciques ouvertes, des membres propagés au quatre coin des rues et des petits bouts d’enfants parsemant les murs et la terre remuée – ça a été de marcher aussi vite que ma jambe me le permettait jusque chez mon meilleur ami. Faute d’y trouver âme qui vive, j’ai découvert un bâtiment ravagé, monticule de gravats parfois aussi gros que moi. J’ai mis plusieurs minutes à accepter que mon meilleur ami et sa copine devaient être morts, tout comme leurs chats. Mais eux avaient une cage de transport et il aurait été bon que je la trouve si je voulais garder mon animal auprès de moi. Je n’avais pas assez de larme pour pleurer tout le monde et l’urgence me rendit plus pragmatique que jamais. Alors, sans perdre les alentours du regard, j’ai commencé à fouiller dans les décombres. Tel un acharné, je soulevais les plaques de placo, les tubes de métal tordus, mes mains se déchirant au contact du verre brisé, se piquant aux fibres d’isolant de mauvaise qualité. Tout était maculé de brûlures, de traces de chaleur intense et de sang, du sang et des morceaux d’organes. Dégageant des bouts de chair, je senti très vite que l’on m’observait. Les oiseaux attendaient patiemment et silencieusement sur les quelques poteaux encore debout, dans les arbres survivants ou en volant au-dessus de ma tête en cercle concentrique. Tout sentait la mort, je sentais la mort. J’ai fini malgré tout par trouver un sac de transport pour animaux. Miraculeusement, celui-ci n’avait pas été très endommagé et les sangles semblaient encore tenir.
Alors me voilà , en train de marcher depuis ce qu’on appelait la butte des Beaux-monts. Comme d’autres sûrement, que je ne croise pas, je dois aller de plus en plus loin chercher de quoi manger. J’ai le chat sur le dos dans le sac, mes chaussures sont défoncées, mon pantalon n’a quasiment plus qu’une seule jambe. Jai dû déchirer l’autre pour plus de confort. Ma jambe droite me rappelant encore violemment que du tissu ne pouvait rester trop longtemps à son contact. Le reste de mon accoutrement n’étaient fait que d’un t-shirt, un pull moutarde désormais trop tâché et une veste aux manches en simili cuir. J’ai un long couteau récupéré dans des décombres tenant dans mon dos grâce à ma ceinture et un flingue pris sur un corps glissé dans ma poche. Je ne me suis jamais servi d’une arme et heureusement, je n’ai pas eu à l’utiliser depuis l’apocalypse. Je n’ai pas appris à user de cela, je ne sais pas si elle est chargée, je ne sais pas comment le vérifier et je ne sais pas non plus comment tirer sur quelqu’un ou quelque chose avec. Je n’ai pas voulu m’y entrainer, par peur de gâcher des munitions inutilement, s’il y en a encore à l’intérieur, mais aussi par crainte d’attirer l’attention en faisant trop de bruit. Le chat reste calme quand je le transporte avec moi. Elle apprend vite. Je pense qu’elle sent, qu’elle sait qu’il faut se faire discret. Et alors qu’avant, la moindre vue d’un oiseau devant la fenêtre la mettait dans tout ses états, elle reste désormais sage, patiente, silencieuse, alors qu’elle n’a jamais vu autant de piaf de sa vie. Je n’ai d’ailleurs croisé que très peu de chats dans mes différentes pérégrinations. M’est avis que des populations doivent se dissimuler dans les bois, alors que les chiens errants ont pris possession des anciennes zones habitées. J’ai pris le temps d’enterrer ma famille par la pensée, sachant qu’il y avait peu de chance pour que j’en revois un seul membre en vie un jour. Je continue donc de marcher en direction du palais impérial, endroit étrangement assez épargné par les ravages, un sac plastique dans la main contenant quelques conserves. De quoi nous sustenter un petit temps. C’est à la tombé de la nuit que je finis par rejoindre la gare détruite et le wagon de marchandise retourné me servant d’abris. Epuisé, je m’endormis rapidement après avoir ouvert une boite de cassoulet.
Des voix, comme des murmures me tirent soudainement de mon sommeil. Mes sens en alerte, je me finis par me glisser lentement jusqu’à la porte ouverte au-dessus de moi. Je jette juste un coup d’œil au chat que je vois, à la lumière de la lune, tous yeux ouverts, observant l’extérieur. Agrippant le pistolet, je passe la tête à travers l’ouverture. L’endroit semble aussi désert que d’ordinaire. Puis, les murmures recommencent. Doux et fantomatiques, ils se réverbèrent à travers le fatras de débris et de wagon dispersés sur des centaines de mètres à la ronde. Je pointe le flingue au dehors, devant mon visage, mes pieds reposant sur des caisses disposées les unes sur les autres. Tentant de repérer la source des chuchotements, je me concentre. Mais les échos brouillent mes sens. Je jette un dernier regard vers le sac de transport, puis je me glisse aussi furtivement que possible au-dehors, me trainant jusque contre l’un des côté du wagon, l’arme toujours en joue. Je ne sais pas m’en servir, mais j’espère néanmoins que cela puisse être dissuasif. Je fais volte-face. Un craquement a attiré mon attention et dans la pénombre, sous les rayons lunaire blafard, je vois alors se dessiner une silhouette, non deux. Un corps haut et fin, accompagné d’un animal se tenant sur ses quatre pattes. Silencieusement, ils s’approchent, lentement, pas à pas, leur présence uniquement trahis par le bruissement des semelles sur les débris.
— Tu n’as rien Ă craindre, lance la voix grave et caverneuse. Nous ne te voulons aucun mal et Bravo n’est pas mĂ©chant. — Qui ĂŞtes-vous ? Demande-je d’une voix ne dissimulant pas ma surprise. — Mon groupe et moi, nous vivons Ă quelques kilomètres d’ici. Nous avons crĂ©Ă© un semblant de communautĂ©. Cela fait quelques temps que je t’observe. — Vous m’observez ? — Tu te croyais sans doute seul au monde depuis la catastrophe. Mais cela n’est pas terminĂ©. La guerre fait encore rage et nous rassemblons tous ceux qui peuvent encore se dĂ©fendre. Nous avons des femmes et des enfants avec nous. Toute protection qui peut leur ĂŞtre donnĂ©e est bonne Ă prendre. Tu as aussi besoin d’un groupe. — Je m’en sors très bien tout seul. — Si j’ai rĂ©ussi Ă te repĂ©rer, d’autres, plus vĂ©hĂ©ment, auraient pu le faire Ă ma place. Je ne sais que rĂ©pondre. — Sais-tu seulement te servir de cette arme que tu pointes vers moi ? — Bien sĂ»r ! Clame-je avec assurance. — Ah oui ? Et es-tu certain d’être parĂ© Ă toute Ă©ventualitĂ© ? — Comment ça ? — Tu te laisses encore sans doute trop distraire.
Je n’entends qu’au dernier moment le bruissement de tissu derrière moi. Je sens soudain une douleur vive à l’arrière de mon crâne, puis la torpeur qui me gagne, laissant s’évanouir les formes et les idées comme de la poussière dans un souffle de vent. Cette histoire fait partie d'un tout plus grand !
|














